Manger au travail

Doc 1 : Cantine de l’usine des Ancizes, années 1950 ; Source : carte postale, collection privée
Dans leurs témoignages, un nombre important de nos interlocuteurs abordent le temps et les moments consacrés à l’alimentation dans le cadre usinier. Ceux-ci peuvent prendre plusieurs formes, selon les circonstances, et ils évoluent durant tout le XXe siècle.
Dans le premier quart du XXe siècle, alors que les Ancizes voient les premiers développements de l’usine (qui salarie selon les années et les fluctuations de la conjoncture entre 50 et 400 ouvriers), les pratiques sont encore celles héritées du XIXe siècle. Désormais, l’emploi du temps usinier façonne le rythme de vie familial où les femmes, – même lorsqu’elles ont un emploi salarié, qu’elles travaillent à la ferme ou ont une activité extérieure (scolaire pour les plus jeunes par exemple) – jouent un rôle fondamental par la fonction nourricière qu’elles occupent.
En effet, le temps de travail est encadré par des collations, préparées par les épouses ou les filles, prises en commun avec les membres de la famille. Ainsi, très tôt le matin, dans le logis familial, les hommes qui partent au travail consomment une boisson chaude, généralement du café ou une soupe. À leur retour, ils partagent un repas en milieu d’après-midi, puis soupent en famille. Le souper est souvent le seul repas pris lorsque la famille est au complet car, selon les fonctions occupées par les uns et les autres, les hommes et les femmes ne suivent pas les mêmes horaires et donc les mêmes rythmes de vie.
À l’usine, les ouvriers font généralement deux pauses, une dans la matinée, vers 7h, consacrée au petit déjeuner, une vers 11h, consacrée elle au déjeuner. Pour ces deux moments, parfois assez longs (entre 30 mn et une heure), plusieurs cas de figure peuvent se présenter. Possiblement – c’est une pratique répandue dans l’Allier voisin donc peut-être en usage aux Ancizes également – la pause du petit déjeuner est animée par la venue, au sein de l’usine, des femmes et filles de travailleurs qui apportent soupe ou café au lait chauds. À midi, pour ceux habitant à proximité, une pratique semble se répandre de plus en plus dans la France industrielle, celle du retour à domicile pour prendre le déjeuner en famille. C’est probablement le cas pour les ouvriers qui résident dans les cités ouvrières qui se construisent au fur et à mesure que l’usine prend de l’ampleur, notamment après le rachat par Aubert et Duval au milieu des années 1920.
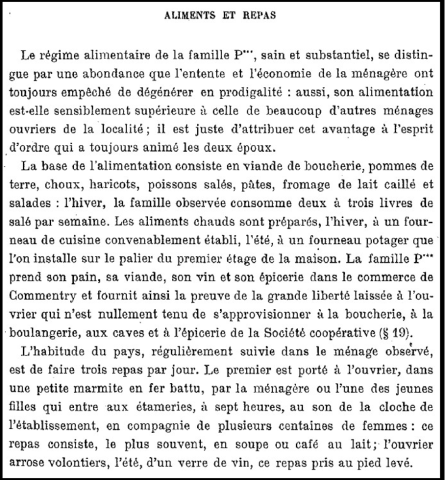
Doc 2 : Les habitudes alimentaires des ouvriers auvergnats, ici ceux d’une famille de Commentry. Source : Les Ouvriers des deux mondes : études sur les travaux, la vie domestique et la condition morale des populations ouvrières des diverses contrées, série 3, fasc. 16, 1905, p. 455.
Pour tous les autres, ceux qui habitent trop loin aux Ancizes ou dans les villages environnants, comme ils le faisaient lorsqu’ils travaillaient dans les champs, ils emportent avec eux une collation préparée à leur domicile par l’une des femmes du logis. C’est la fameuse « gamelle » ou le « casse-croute », une pratique qui perdure tout au long du XXe siècle. Les célibataires, eux, peuvent trouver à proximité de l’usine divers endroits où l’on prépare des casse-croûtes à emporter ou à consommer sur le pouce. C’est une clientèle captive qui, souvent, ne dispose ni des moyens pour préparer à manger ni famille pour s’y atteler. Ils dépensent donc une partie de leurs revenus dans le repas du midi voire du soir chez les débitants et restaurateurs qui se développent durant l’Entre-deux-guerres autour de l’aciérie (quartiers de la gare – chez Mme Gilbert – ou de l’usine – bistrots Desarmenien ou Gumy – dans les années 1930). Avec l’accroissement de l’activité dans les années d’après-guerre, et donc l’accroissement du personnel, le nombre de débits augmente autour de l’usine. De quelques-uns dans les années 1930, on passe à huit troquets au tournant des années 1950, l’écrasante majorité étant tenue par des femmes, assurant ici encore le ravitaillement des travailleurs. Au-delà de la croissance entrepreneuriale, l’Entre-deux-guerres puis surtout les Trente Glorieuses, nous l’avons vu [lien vers l’article sur migrations ici], voient l’arrivée de travailleurs déracinés, sans famille à la fois pour leur préparer et partager leur repas.

Doc 3 : La pause repas d’ouvriers auvergnats, ici des mineurs de Saint-Éloy-les-Mines. Source : Carte postale vers 1900, Archives du Puy-de-Dôme.
Pour partager leur repas, à compter de ces années 1930 avec certitude (et peut-être déjà dans les années 1920, mais les sources sont muettes à ce sujet), les ouvriers peuvent disposer d’une cantine collective. Ils trouvent alors un lieu où ils peuvent consommer la nourriture apportée de chez eux ou, surtout, acheter des repas chauds, préparés sur place (les recensements indiquent à compter du milieu des années 1930 la présence d’un « restaurateur » employé par Aubert-et-Duval, assumant surement les fonctions de cuistot pour la cantine). C’est là un moyen commode et économique de pouvoir manger sur place pour ceux qui n’ont ni le temps de rentrer chez eux, ni la possibilité de se préparer ou de se faire préparer de quoi manger. La double offre débitants privés/cantine de l’usine se perpétue dans les décennies qui suivent, avec des modulations, tout d’abord dans la modernisation des structures de consommation (réfection des salles, amélioration des équipements, etc.), tout comme leur diversification (apparition d’un food truck par exemple dans les années 2010). De fait, les espaces où les ouvriers et les employés s’alimentent restent des lieux centraux de l’univers usinier, par leur dimension nourricière bien évidemment, mais également leurs fonctions sociales.
C’est pourquoi les patrons y accordent une si grande attention. Pour eux, la cantine est bien sûr un moyen d’éviter que les ouvriers dépensent leur argent chez des intermédiaires aux tarifs plus élevés que la cantine, mais aussi dans le même temps un outil de contrôle du temps, des déplacements et des regroupements des ouvriers. Cela explique également pourquoi ils prennent soin d’avoir de bonnes relations avec les patrons – qui sont rappelons-le la plupart du temps des patronnes, en témoignent les noms de café comme « Chez Marie » ou « La Mélie » – des estaminets ou des restaurants. Parfois, des veuves d’ouvriers se voient même offrir par l’usine bail et fonds de commerce afin de tenir un café-restaurant, tout en faisant respecter dans leur établissement l’ordre usinier (modération dans les paroles et dans les consommations). Car si manger permet de prendre des forces, de se reposer (en s’asseyant), de partager la nourriture dans un moment de convivialité avec ses collègues (parfois venant d’autres ateliers, parfois d’autres services), c’est aussi un moment de discussions politiques, de dispersion, parfois d’excès. En d’autres mots, des dérives que les patrons veulent éviter, tant pour eux l’ouvrier doit être focalisé sur sa fonction première : la production.

Doc 4 : Cantine d’entreprise, sans lieu, années 1940 (détail) ; Source : bibliothèque historique de la ville de Paris

Doc 4 alternatif : Cantine des aciéries de Saint-Chamond, vers 1910 ; Source : carte postale, collection privée
Ce souci du contrôle par l’alimentation explique que très tôt la direction permette l’ouverture d’une coopérative du personnel (1922). Cette structure commerciale, qui vient compléter l’offre dans les bourgs environnants [lien vers article en question], permet aux ouvriers d’acquérir des produits alimentaires à prix compétitifs et surtout d’avoir droits à des ristournes et un retour sur investissement en fin d’année [à confirmer avec archives]. Dans le même esprit, en 1942, est créée sous l’égide de l’entreprise l’Association des jardins familiaux et industriels de l’Aciérie des Ancizes. Ces jardins ouvriers permettent de produire, dans de petits potagers familiaux, ses propres fruits et légumes (surtout en période de restriction et de pénurie au moment de leur fondation). Mais c’est aussi un moyen d’occuper les ouvriers et d’éviter qu’ils ne passent leur temps libre à des activités moins louables (notamment se rendre au café pour jouer, discuter, lire la presse ou boire). Ainsi, coopérative et jardins permettent aux familles ouvrières de produire de quoi nourrir la famille et d’épargner, mais elles revêtent également une dimension sociale et politique importante. En témoigne toute l’attention portée par les patrons et les syndicats ouvriers à cette question alimentaire. En témoigne également Le Libertaire, journal anarchiste, qui en 1951, en pleine période de plan Marshall et d’américanisation à marche forcée en France, reproche aux patrons de l’usine des Ancizes de vendre du Coca-Cola bien glacé dans les ateliers…
Enfin, le lieu de travail est aussi celui des repas de fêtes. Les repas peuvent alors regrouper plusieurs personnes d’un même atelier pour célébrer un évènement personnel heureux (naissance, mariage) ou malheureux (décès). Au-delà, le personnel à plus grande échelle peut participer à des fêtes corporatives, véritables rites du monde ouvrier que l’on célèbre unis derrière la bannière d’un saint protecteur (saint Eloi pour les travailleurs du fer par exemple début décembre) ou celle d’un syndicat (Premier mai bien évidemment). Ces fêtes sont là aussi souvent l’occasion d’excès, d’emportements ou de perturbations de l’univers usinier, expliquant que, dans le dernier tiers du XXe siècle, elles soient de plus en plus encadrées ou remplacées par des fêtes et repas organisés par l’entreprise elle-même. C’est le cas par exemple des arbres de Noël, qui, tout en prolongeant l’idéal paternaliste de la direction (coopérative du personnel, cité, cantine durant l’Entre-deux-Guerres), assurent le renforcement de la culture d’entreprise. Ces repas exceptionnels permettent également un brassage social au sein de l’entreprise, ce que les repas pris en commun quotidiennement ne permettent pas réellement (car trop rapides, souvent avec les mêmes collègues de l’atelier, dans un temps et un cadre très contraints). Mais les ouvriers, au moins jusqu’à une date très récente, trouvent dans des repas collectifs plus ou moins indépendants un moyen de tisser ou de renforcer des liens de convivialité et de solidarité hors du contrôle de l’employeur, par exemple en instaurant des repas communs réguliers, notamment le vendredi autour d’un met collectif, pièce de bœuf ou plat local



